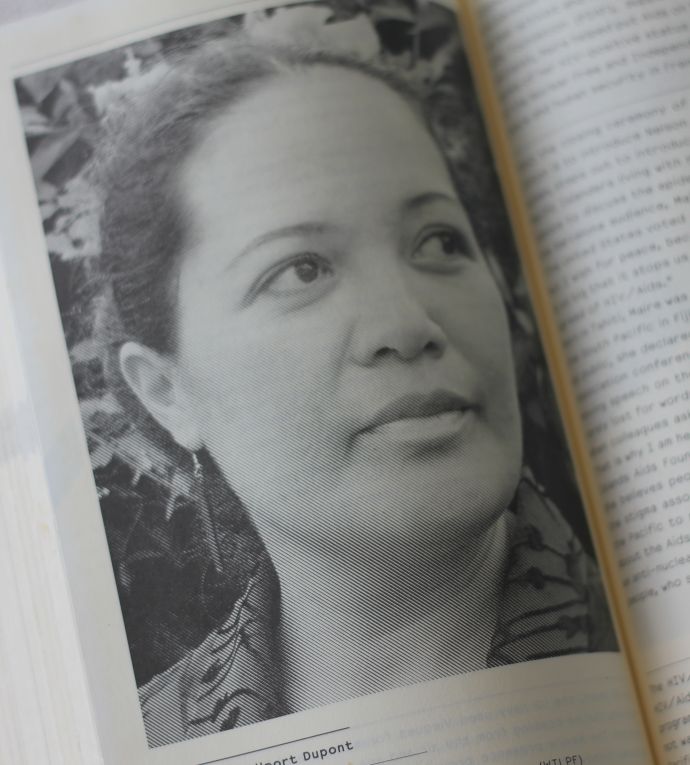La baisse généralisée des aides publiques au développement (APD) des pays historiquement donateurs, emmenés par les États-Unis, comme le désengagement des instances multilatérales malmènent la santé mondiale. Une situation qui pourrait avoir des conséquences sanitaires majeures à l’échelle globale.
Retrait de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), gel du PEPFAR (plan d’aide d’urgence à la lutte contre le sida), réduction drastique du budget de l’USAID… Les États-Unis de Donald Trump sont le fer de lance du mouvement actuel de baisse des aides publiques au développement (APD) et du désengagement des instances multilatérales. Mais cette tendance est généralisée.
Des restrictions budgétaires ont même précédé les tonitruantes annonces depuis le bureau ovale, puisque l’OCDE constatait dès 2024 une diminution de l’aide internationale fournie par les donneurs publics de l’ordre de 7,1 % par rapport à 2023 [i]. La France fait partie des pays qui ont devancé Washington en la matière en entamant des coupes soudaines dans le budget de l’APD dès début 2024.
La santé, parent pauvre de l’aide au développement
Gautier Centlivre, coordinateur de plaidoyer pour l’ONG Action santé mondiale, retient toutefois que pour la France, « la part de l’aide publique au développement destinée à des actions de santé fluctue entre 8 et 10 % ». Cela comporte à la fois les aides bilatérales directement allouées à des pays receveurs et la contribution de la France à des fonds multilatéraux (Gavi, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Unitaid…) qui s’élève à environ 500 millions d’euros par an, d’après le ministère des affaires étrangères. Une somme à mettre en regard avec les 14 milliards de l’APD française en 2024, et les 1500 milliards de recettes publiques de la France. La part allouée à la santé mondiale est donc modeste et jugée largement insuffisante par les ONG de la solidarité internationale. Pourtant la France réduit son engagement dans le secteur.
Contributions en baisse
Pour preuve, Paris a récemment revu à la baisse sa participation à Gavi [ii], l’alliance pour le vaccin. La contribution française passe de 760 millions d’euros à 500 millions pour le prochain cycle 2026-2030, alors même que le président Emmanuel Macron s’était engagé en 2024 à maintien de l’investissement français. La reconstitution imminente du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme risque de prendre la même tournure, avec les contributions des principaux donateurs (Etats-Unis, France) largement en baisse. Les progrès sanitaires réalisés par ces fonds multilatéraux qui permettent de mutualiser les efforts sont pourtant colossaux.
« On est tous lié en termes de santé, ce qui se passe à un endroit afefctera un autre endroit. »
Le Fonds mondial revendique avoir sauvé 70 millions de vie depuis sa création en 2002. Dans les pays qui en sont bénéficiaires, le nombre de décès liés au sida a diminué de 82 % en 2024 par rapport à 2002, le nombre de décès imputables au paludisme de 51 %, et de 57 % pour la tuberculose. Gavi, l’alliance pour le vaccin a permis de vacciner 1,1 de personnes et d’éviter plus de 18 millions de décès depuis l’an 2000.
« Nous sommes dans un moment historique de remise en cause de l’ensemble des mécanismes de coopération internationale, et la santé est tout sauf la priorité », résume Joseph Larmarange, chercheur en santé mondiale et spécialiste des inégalités en santé au Ceped. « Tous les mécanismes qui avaient permis de canaliser les APD, de négocier des prix sur les marchés, d’introduire des médicaments dans les pays… sont fortement impactés par la tendance baissière généralisée des aides publiques au développement », décrit Nathalie Ernoult, co-directrice de l’observatoire de la santé mondiale à l’IRIS (institut des relations internationales et stratégiques).
Des millions de décès
L’arrêt d’activités financées par le PEPFAR et l’USAID, grands bailleurs étasuniens de la santé mondiale et de la lutte contre le VIH, se fait déjà sentir. « Des impacts sont visibles : baisse du niveau de surveillance, moins de diagnostic, des ruptures de stock, la supply chain impactée… » énumère Nathalie Ernoult. « Ce qui est le plus dé-priorisé, ce sont les relais communautaires », décrit-elle.
Sur le terrain, les associations observent déjà une hausse des contaminations VIH, corroborant des scénarios modélisant la reprise de l’épidémie. Un article de la revue scientifique The Lancet estime quant à lui que l’ensemble des coupes budgétaires dans l’aide au développement des États-Unis pourrait causer d’ici 2030 la mort de 14 millions de personnes, dont un tiers d’enfants, dans les pays les plus vulnérables.
Joseph Larmarange a participé à une modélisation de l’impact du retrait du PEPFAR pour l’Afrique de l’Ouest, qui conclut également à une reprise de l’épidémie de VIH. Ce qui marque le chercheur ? « Les économies réalisées par vie perdue – puisque c’est de cela dont on parle – sont faibles. » Une année de vie en bonne santé en Côte d’Ivoire correspondrait à 400 dollars. « Ce qu’on économise aujourd’hui, on risque de le payer plus cher, plus tard ».
Le Creusement des inégalités
On ignore encore largement quelles activités précédemment financées par des bailleurs internationaux seront reprises par les États eux-mêmes. « Les pays ne sont pas égaux face à ces coupes. Les pays à revenus intermédiaires ont plus de capacité à se réorganiser. Pour les pays à bas revenus, c’est difficile à mesurer à ce stade », pour Nathalie Ernoult. « On risque de s’acheminer vers des standards assez différents. Depuis des années, l’idée était de faire que les populations de tous les pays aient accès aux mêmes traitements. Des écarts vont se recreuser dans l’accès aux traitements », envisage la chercheuse de l’IRIS.
Les pays donateurs ne seront pas indemnes face à cette dégradation de la santé mondiale. « On est tous lié en termes de santé, ce qui se passe à un endroit impactera à un autre, surtout pour les maladies transmissibles », commente Nathalie Ernoult. Ces futurs impacts sont pour l’instant quasiment impossibles à modéliser et quantifier. Gautier Centlivre d’Action santé mondiale parle de « risques en cascade : les maladies vont continuer de se propager et des résistances vont se développer ».
Les fortes circulations à l’échelle mondiale et le dérèglement climatique renforcent les risques de nouvelles zoonoses et de maladies émergentes. « Ce qu’on affaiblit, c’est notre capacité à répondre collectivement aux thématiques de santé », prévient Gautier Centlivre. Pour Action santé mondiale, « si les dirigeants français ont pour intérêt de protéger leur population, il faut investir dans les systèmes de santé à l’international, car les virus n’ont pas de frontière ». 🟥
[i] L’aide internationale recule en 2024 pour la première fois en six ans, selon l’OCDE.
[ii] Gavi, l’Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation, (en anglais : Global Alliance for Vaccines and Immunization), est une organisation internationale créée en 2000 pour sauver la vie des enfants et protéger la santé des populations en augmentant l’utilisation équitable des vaccins dans les pays à faible revenu.
 Aide publique au développement : la santé mondiale à l’aube de bouleversements majeurs ?
Aide publique au développement : la santé mondiale à l’aube de bouleversements majeurs ?