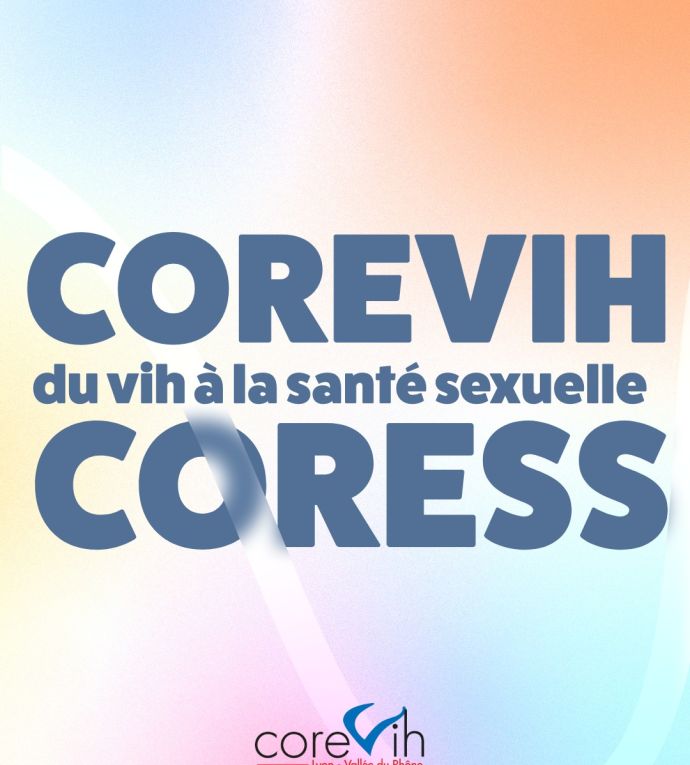Depuis mars 2025, les COREVIH ont été remplacés par les CoReSS, marquant une évolution majeure de la coordination régionale en matière de santé sexuelle. Conçue pour mieux répondre aux réalités du terrain et élargir les missions des comités, la réforme suscite toutefois des inquiétudes dans plusieurs régions, entre tensions budgétaires et gouvernance redéfinie.
Depuis 2007, les COREVIH (Comités de coordination de la lutte contre le VIH) coordonnaient les acteurs de la lutte contre le VIH en région, avant d’être étendus aux IST en 2017. Le 15 mars 2025, ils ont officiellement été remplacés par les CoReSS (Comités de Coordination Régionaux en Santé Sexuelle). Cette réforme, pensée pour mieux répondre aux réalités sanitaires et sociales actuelles, s’inscrit dans une double dynamique : d’un côté, le besoin exprimé par les acteurs de terrain de moderniser un dispositif parfois perçu comme trop cloisonné ; de l’autre, une volonté nationale d’intégrer le VIH dans une approche globale de santé sexuelle, avec la fin d’un plan VIH spécifique.
« Il y a quelques années, les responsables des COREVIH avaient déjà engagé une réflexion structurée et soumis des propositions concrètes à la Direction générale de la santé (DGS). Puis a été publié, en 2023, le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas). La convergence de ces initiatives a mis en évidence la nécessité de repenser les missions et le fonctionnement des COREVIH », retrace Catherine Aumond, vice-présidente du CoReSS Centre-Val de Loire et secrétaire générale de AIDES.
Des missions élargies
Le champ d’action des CoReSS s’élargit à l’ensemble de la santé sexuelle : en plus de coordonner la lutte contre le VIH et les IST, les comités couvrent désormais l’accès à la contraception (hors IVG), les violences sexuelles et les troubles de la sexualité. « Il était nécessaire de faire évoluer des dispositifs qui correspondaient à une époque où l’on traitait le VIH avant tout comme une maladie infectieuse », souligne le Dr Luc Ginot, directeur de la Santé publique à l’Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France.
Ce repositionnement obéit également à une logique de convergence. « Les leviers mobilisés dans la lutte contre le VIH sont largement similaires à ceux de la santé sexuelle, avec des publics ou des déterminants (par exemple les discriminations) souvent communs. La réforme répond également à une demande partagée par les acteurs du VIH, de la planification familiale et des luttes communautaires, qui pointaient des approches devenues redondantes ou dépassées. Il ne s’agit pas d’une logique de réduction des coûts, mais bien d’une volonté de mutualiser les compétences face à une réalité de terrain en évolution », poursuit-il.
Dans cette configuration, les Agences régionales de santé (ARS) conservent leur rôle de pilotage de la lutte contre le VIH, désormais inscrit plus largement dans le champ de la santé sexuelle, en s’appuyant sur les CoReSS, dont elles coordonnent les actions. La nouveauté tient à la généralisation d’un contrat d’objectifs et de moyens, désormais obligatoire, qui formalise cette collaboration dans chaque région.
Sur le terrain, la réforme avance à des rythmes inégaux. Si la plupart des régions ont vu les arrêtés de nomination des membres des CoReSS publiés, la constitution effective des bureaux et la définition des missions sont encore en cours. Certaines régions, comme le Centre-Val de Loire, bénéficient d’un climat apaisé et d’un dialogue fluide avec leur ARS. « Notre budget est resté stable, nous ne nous sentons pas en difficulté, mais nous sommes conscients d’être dans une situation privilégiée », note Catherine Aumond.
Ailleurs, le climat est plus tendu. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), la fusion des deux COREVIH Provence-Alpes-Corse (POC) et PACA-Est a été vécue comme un « mariage forcé ». « On nous a imposé cette fusion sans nous consulter. Ce n’est pas que l’idée soit mauvaise, mais réduire les moyens tout en augmentant les missions, c’est compliqué », déplore le Dr Erika Kurzawa, présidente du COREVIH PACA POC, qui a choisi de ne pas siéger au sein du nouveau CoReSS : « Cela m’a épuisée de devoir me battre pour ce qui me semblait être de l’acquis et du bon sens humain ».
Dans le Grand Est, les difficultés sont d’un autre ordre : juste avant l’élection du bureau du CoReSS, l’ARS a transféré le CHU porteur de Strasbourg à Nancy, entraînant l’arrêt brutal de certains contrats et laissant les équipes déstabilisées. Le Dr Patrick Philibert, infectiologue et ancien membre du bureau du COREVIH, ne cache pas sa colère devant ces méthodes : « Nous savions que la réforme était dans les tiroirs depuis un moment, mais cela s’est fait dans la précipitation et sans véritable concertation, avec des décisions imposées par l’ARS ».
Moins de moyens et plus d’incertitudes
La question des moyens humains et financiers reste aussi au cœur des préoccupations. Une consultation menée en janvier par la coordination nationale des COREVIH révèle que 44 % des comités ont reçu de leur ARS des consignes de non-renouvellement de CDD, de réduction d’effectifs ou de gel des recrutements. Cette contraction menace directement certaines missions essentielles, à commencer par le suivi épidémiologique.
« Si nous ne disposons plus du même nombre de techniciens, comment suivre l’évolution de l’épidémie de VIH ? Nous ne pouvons pas attendre des données nationales qui ne seront peut-être jamais produites », s’inquiète Erika Kurzawa. Le manque de visibilité accentue le malaise. Dans mon hôpital, un poste est financé par le COREVIH. Aujourd’hui, je ne sais toujours pas s’il sera reconduit », rapporte le Dr Patrick Philibert. « Nous sommes en avril 2025, les CoReSS sont en place, et l’ARS ne nous donne aucune information ».
Face à ces inquiétudes, le Dr Luc Ginot propose une lecture différente : « Les missions évoluent, avec des compétences à adapter ou à développer, mais il n’a jamais été question de réduire les moyens dans le cadre de la réforme. En Île-de-France, les moyens ont été maintenus et notre volonté est d’accompagner les personnels dans cette transition, sans brutalité ».
Nouveaux acteurs, nouveaux équilibres
La réforme rebat également les cartes de la gouvernance en santé sexuelle. « Il va falloir être très vigilants sur l’inclusion des acteurs historiques de la lutte contre le VIH, prévient Erika Kurzawa. L’ARS est seule décisionnaire sur la composition des CoRESS, et il ne faudrait pas que les associations de terrain se retrouvent écartées ». Pour Catherine Aumond également, il est essentiel de préserver l’esprit de démocratie sanitaire qui animait les COREVIH : « Il faudra s’assurer que la parole des usagers reste centrale ».
Patrick Philibert redoute quant à lui un effacement progressif des priorités historiques : « Le risque est que la santé sexuelle devienne un fourre-tout où le VIH perde sa visibilité ». Un point de vigilance que partage le Dr Luc Ginot : « Il est hors de question que la lutte contre le VIH soit reléguée au second plan. L’épidémie n’est pas derrière nous : elle a évolué, touche aujourd’hui des publics différents et soulève de nouveaux enjeux épidémiologiques ».
Son ARS a d’ailleurs lancé le programme VIH Zéro en Île-de-France, en partenariat avec l’ANRS : « Ce programme très ciblé repose en grande partie sur les CoReSS. L’objectif est de construire, avec les partenaires sur le terrain, des actions très opérationnelles ». Mais pour que cela fonctionne, une condition est indispensable : associer pleinement les acteurs concernés. « Tout ce que nous avons réussi en santé publique, nous l’avons toujours accompli avec les communautés », précise Luc Ginot. Autrement dit, avec les groupes directement touchés par les inégalités de santé, personnes LGBT+, migrants, publics précaires, travailleurs du sexe, jeunes, etc. « Si l’on agit sans eux, nous allons à l’échec. Je n’ai aucun doute à ce sujet », conclut le directeur de la santé publique de l’ARS Île-de-France.
Pour les ARS, il s’agira donc de maintenir un dialogue étroit avec l’ensemble des acteurs impliqués, en particulier ceux issus des communautés concernées. Reste à voir si ce nouveau pilotage tiendra ses promesses dans la durée. « Chez AIDES, nous restons mobilisés pour que le VIH conserve toute sa place au sein des CoReSS et nous regarderons d’ici 18 mois à deux ans comment les CoReSS ont évolué », avertit Catherine Aumond.
 Des COREVIH aux CoReSS, une refondation qui divise les territoires
Des COREVIH aux CoReSS, une refondation qui divise les territoires