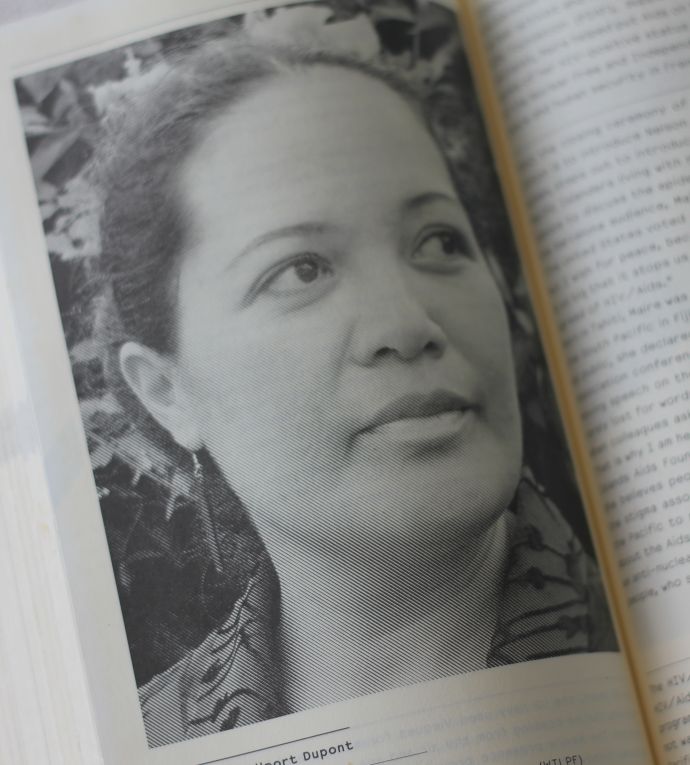L’association Acceptess-T a ouvert trois centres d’hébergement pour personnes trans, à Paris et à Saint-Denis. Inédite en France, cette offre vise à autonomiser les personnes et lutter contre la précarité croissante qu’endure une grande part de cette population. A l’occasion du Mois des fiertés, Transversal fait le point.
Située dans le 19ème arrondissement, la Maison des Iris, ouverte fin mars, dispose d’une capacité d’accueil de six personnes. A Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ce sont huit places qui sont réparties entre la Maison des Orchidées et la Maison des Tournesols. A l’origine de ce projet d’Acceptess-T, le constat des difficultés qu’endurent les personnes trans à accéder aux dispositifs d’hébergement.
Au manque généralisé d’offre, s’ajoute la difficulté à orienter au mieux ces personnes. En particulier celles en début de parcours de transition, explique la directrice d’Acceptess-T, Giovanna Rincon : « Les services peinent à savoir comment placer les personnes, afin d’éviter qu’elles soient victimes de discriminations ou de violences dans le dispositif ». Ces difficultés sont devenues encore plus aigües depuis la crise Covid-19, dont la partie la plus précaire de la population trans ne s’est pas relevée.
La mise à l’abri, l’une des priorités d’Acceptess-T
Face à ces situations de détresse, Acceptess-T apporte depuis plusieurs années une aide financière à ses bénéficiaires, soit en leur payant des nuits d’hôtel, soit en participant directement à leur loyer. Avec l’ouverture de ses trois premiers centres d’accueil, l’association a décidé de passer à la vitesse supérieure, alliant plus résolument hébergement et accompagnement.
« Nous avons d’abord pensé ce dispositif comme une possibilité d’accompagner les jeunes personnes trans, mais nous avons évolué à ce sujet. Il est ouvert à toute personne trans, indépendamment de l’âge et du statut de séjour en France, mais avec une attention particulière aux plus jeunes, aux plus âgé.e.s, aux plus fragiles », explique Giovanna Rincon.
Une fois installées, les personnes bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour accéder à un travail, une formation et un logement stable. « Il faut faire en sorte que le séjour soit le plus court possible, mais ce ne doit pas être une règle fondamentale. Certaines personnes n’auront besoin que de six mois, pour d’autres cela prendra plus de temps, en fonction des besoins », explique la directrice d’Acceptess-T.
Selon elle, l’hébergement des personnes trans en précarité, auquel l’Etat peine à apporter des réponses, pourrait reposer de plus en plus sur le secteur associatif. « Nous sommes au début d’un nouvel élargissement de notre association, ce qui va nous poser des questions importantes d’un point de vue structurel. Nous avons créé 14 places d’hébergement, mais le nombre de demandes est déjà très important », conclut Giovanna Rincon.
Au croisement de toutes les précarités
Menée entre 2020 et 2022 par menée par le Sesstim [i] et Acceptess-T, l’étude Trans & VIH révèle l’étendue des difficultés rencontrées par de nombreuses personnes transgenres. A l’origine de cette étude, le constat d’un manque de connaissances, faute d’études spécifiques, quant à cette population fortement impactée par le VIH. « Les travaux menés dans d’autres pays montrent qu’il s’agit d’une population à prévalence très élevée, de 19 % à 30 % selon les groupes et les études », explique Margot Annequin, postdoctorante au Sesstim.
Pour mener cette étude, les investigateurs ont lancé un appel à 36 centres de prise en charge du VIH, leur demandant de recenser les femmes trans de leur file active. Parmi les 777 personnes déclarées par les centres, 536 ont pu être inclues dans l’étude, menée sur la base d’entretiens individuels avec des intervenantes trans. Les résultats confirment la grande vulnérabilité de ce public : parmi ces femmes, 86 % de nationalité étrangère (le plus souvent d’Amérique du Sud), 30 % ne disposent pas de titre de séjours, 69 % gagnent moins de 1.000 euros par mois, et 65 % vivent de relations sexuelles tarifées.
Des parcours de vie propices à l’acquisition du VIH
Pour Margot Annequin, « c’est surtout la combinaison de transidentité et de migration qui expose les personnes au VIH. De plus, cette population présente, en moyenne, un très faible niveau d’études. Beaucoup de ces personnes se sont visibilisées très jeunes en tant que femmes transgenres, en médiane à l’âge de 13 ans ». D’où des ruptures familiales précoces, obligeant à se réinstaller dans de grandes villes, où, faute d’études, le travail du sexe constitue souvent la seule option.
Une fois en France, ces femmes sont confrontées à de nombreuses difficultés matérielles, dont l’accès, toujours plus ardu, au titre de séjour. Egalement en cause, les violences, source de mal-être psychique : « Un quart de ces personnes sont dans des situations de dépression modérée à sévère, et beaucoup ont commis des tentatives de suicide au cours de leur vie », constate Margot Annequin.
[i] Le Sesstim (Sciences économiques et sociales de la santé & traitement de l’information médicale) est une unité mixte de recherche (UMR) placée sous l’égide de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et d’Aix-Marseille Université.
 En Île-de-France, de premiers centres d’hébergement pour personnes trans
En Île-de-France, de premiers centres d’hébergement pour personnes trans