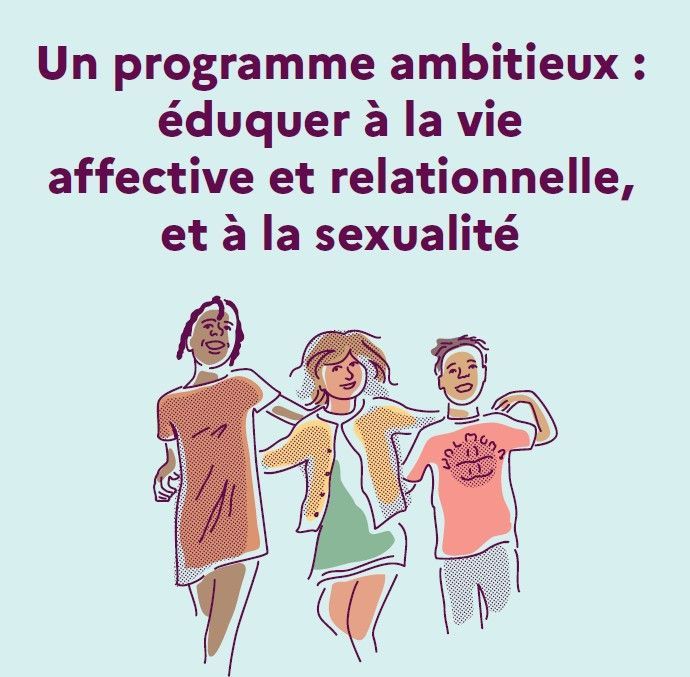Attendu de longue date par les enseignants et les associations, le premier programme officiel d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) est entré en vigueur lors de la rentrée de septembre. Pourtant, les freins semblent loin d’être levés.
Pour les partisans de l’EVARS, qui n’ont cessé d’exiger son application effective, la mise en place d’un premier programme officiel, appliqué depuis la rentrée de septembre, est l’aboutissement d’un long chemin. Un combat mené depuis la loi Aubry du 4 juillet 2001, qui prévoit trois séances annuelles d’EVARS pour toute classe de l’âge du CP à la terminale. Car 24 ans plus tard, rares sont les élèves à en avoir réellement bénéficié : selon une enquête menée dans une académie, seuls 14,7 % des écoliers ont reçu trois séances d’éducation à la sexualité (EAS) au cours de l’année scolaire 2018-2019, contre 20 % des collégiens et 14 % des lycéens.
Les raisons de ce retard sont nombreuses : manque de formation, manque de temps… mais aussi méconnaissance de nombreux parents quant aux objectifs de l’EVARS. Pire, celle-ci fait l’objet d’attaques toujours plus virulentes de la part d’associations proches de la droite conservatrice ou de l’extrême droite. Très actives sur les réseaux sociaux, elles animent depuis quelques années une campagne de désinformation sur l’EVARS, accusée de ‘wokisme’, voire d’inculquer des pratiques sexuelles à de jeunes enfants. A l’opposé de ce qu’est l’EVARS, dont l’objet est l’apprentissage de la tolérance, du consentement et du vivre-ensemble.
La mise en place du programme d’EVARS suffira-t-elle à garantir le droit des élèves à bénéficier de cet enseignement ? Rien n’est moins sûr. Dans un communiqué publié le 30 octobre, le Conseil national du sida et des hépatites virales (CNS) dit « s’inquiéter de remontées du terrain faisant état d’une application encore inégale de l’EVARS, marquée par des disparités territoriales, un manque de ressources humaines et une formation insuffisante des équipes pédagogiques, ainsi que l’intervention d’acteurs extérieurs proposant des contenus contraires aux objectifs et aux valeurs du programme ».
Toujours le même manque de moyens
Les témoignages recueillis par Transversal confirment les difficultés persistantes du déploiement de l’EVARS dans les établissements scolaires. « Cela évolue, mais pas aussi vite qu’on l’aurait souhaité », explique Audrey Chanonat, principale de collège à Cognac (Charente) et secrétaire nationale de la commission éducation et pédagogie du SNPDEN [i], qui a elle-même participé à l’élaboration du programme d’EVARS. En cause, le manque de personnel formé, là aussi par pénurie de formations et de formateurs.
« Nous sommes confrontés au même problème qu’il y a 10 ans : dans les conditions actuelles, on ne pourra jamais mettre en place les trois séances annuelles pour chaque classe d’âge, par manque de personnes formées et de ressources », ajoute Audrey Chanonat. Un constat partagé par Emilie Bacro, secrétaire générale de l’Association des professeurs de biologie et géologie (APBG), elle-même professeure de sciences de la vie et de la Terre (SVT) dans un lycée du Nord : si elle salue l’arrivée du programme d’EVARS, jugé de grande qualité, elle regrette que « nous [n’ayons] toujours pas d’heures dédiées. C’est un programme sans cadre horaire ni financier, donc il demeure difficile à mettre en œuvre » [ii].
Point positif, l’existence d’un programme « fait tout de même bouger les choses », ajoute Emilie Bacro. « Dans mon lycée, le chef d’établissement a remis en place le CESCE [comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement]. De manière générale, l’arrivée du programme oblige les chefs d’établissement à remettre ces questions sur la table ». Il permettra aussi de « pérenniser », ou de renforcer, les actions déjà menées dans les établissements où l’EVARS était déjà enseignée.
Voire, dans les établissements où cet enseignement reposait sur une seule personne (professeur ou infirmier.e scolaire), de briser leur isolement. Du fait de son caractère multidisciplinaire, le programme ouvre la thématique bien au-delà des seules SVT. « Il permet des liens vers le français, vers l’histoire-géo, etc. Peut-être que certains collègues trouveront là des idées à intégrer dans leurs cours, par exemple sur l’égalité filles-garçons », espère Emilie Bacro. En revanche, le programme sera probablement sans grand secours dans les établissements « où rien n’était fait » : « comme il n’y a toujours ni horaires ni financement, il est probable rien ne s’y fera ».
L’extrême droite aux aguets
Qu’en est-il des attaques menées par des associations de parents réfractaires à l’EVARS, voire de ceux qui retiraient leurs enfants lors des séances annoncées à l’avance ? « Cela ne s’est pas tout à fait éteint, bien au contraire », constate Audrey Chanonat. « L’écriture de ce programme a justement mis en exergue le sujet au niveau médiatique, et des parents qui étaient finalement peu au courant l’ont été bien davantage. En tant que chefs d’établissement, nous avons été interpelés par certaines associations, souvent de droite voire plus, qui luttent contre ces programmes ».
Aussi inachevée soit-elle, la formalisation du cadre de l’EVARS permet de mieux protéger le personnel face aux attaques réactionnaires et aux dénonciations sur réseaux sociaux. Lors de la rédaction des programmes, « nous avons insisté pour que des thèmes comme le féminicide et l’homosexualité y soient abordés. Ce sont désormais des programmes officiels, ce qui protège mieux les enseignants. Cela nous permet d’apporter des réponses plus pertinentes aux parents », explique la principale de collège.
Les programmes étant disponibles sur internet, en libre accès à tous les parents, il sera plus difficile de projeter sur eux des « fantasmes » infondés, complète Emilie Bacro. De même, s’il était, avant même l’arrivée des programmes, interdit de ‘sécher’ les cours, les absences afin d’éviter l’EVARS seront plus difficiles à justifier. Quant aux associations anti-EVARS, elles n’ont pas baissé les armes. Dans un article publié début octobre, Mediapart a révélé, en Occitanie, plusieurs tentatives d’entrisme de militants d’extrême droite dans les deux principales associations de parents d’élèves, à savoir la Peep et la FCPE [iii].
En primaire, quelle place pour les associations ?
Au-delà des collèges et des lycées, d’autres difficultés se posent dans les écoles. Dans une circulaire publiée en février, le ministère de l’Education nationale a omis la possibilité de recourir à des associations extérieures lors des séances menées dans le primaire. Depuis, une FAQ (Foire aux questions) est venue enfoncer le clou : dans sa version d’octobre, elle indique que l’intervention de partenaires extérieures est possible en collège et lycée, mais elle ne peut avoir lieu qu’« à titre exceptionnel » dans les écoles. Bien que sans valeur juridique, cette FAQ a pris le pas sur la loi de 2001, qui prévoit la participation d’associations dans tout type d’établissement.
Dans plusieurs départements, les associations se sont ainsi vues, du jour au lendemain, mises à l’écart d’écoles où elles intervenaient ponctuellement, selon les interprétations qu’en faisaient les directeurs académiques des services de l’éducation nationale (Dasen). Tel est le cas du Planning familial, notamment en Isère, qui en fin d’année scolaire 2024-25 s’est vu notifier par plusieurs directeur.rice.s, préalablement briefé.e.s par leur Dasen, qu’il ne pourrait plus intervenir dans leurs établissements.
Selon Léa Delahaye, chargée de communication et de mobilisation du Planning familial de l’Isère, « nous avions plusieurs partenariats depuis une dizaine d’années, qui se passaient très bien. Or depuis la rentrée, il est nous est impossible d’intervenir dans l’ensemble des écoles primaires de la ville de Grenoble, où nous nous rendions depuis très longtemps ». Si ce blocage semble en cours de résolution au niveau du ministère, il semble peu probable que les associations puissent revenir dans les écoles avant septembre 2026, les emplois du temps étant déjà calés. 🟥
[i] Syndicat national des personnels de direction de l’Education nationale
[ii] Au moment de la publication de cet article, le projet de loi de finance 2026 en cours de discussion à l’Assemblée nationale ne prévoit toujours aucune ligne budgétaire pour la mise en œuvre de l’EVARS, qu’il s’agisse du pilotage académique, de la formation des personnels de l’Education nationale, des matériels, des ressources et outils ou des interventions extérieures.
[iii] Peep : Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public. FCPE : Fédération des conseils de parents d’élèves.
 EVARS : un programme scolaire… et après ?
EVARS : un programme scolaire… et après ?